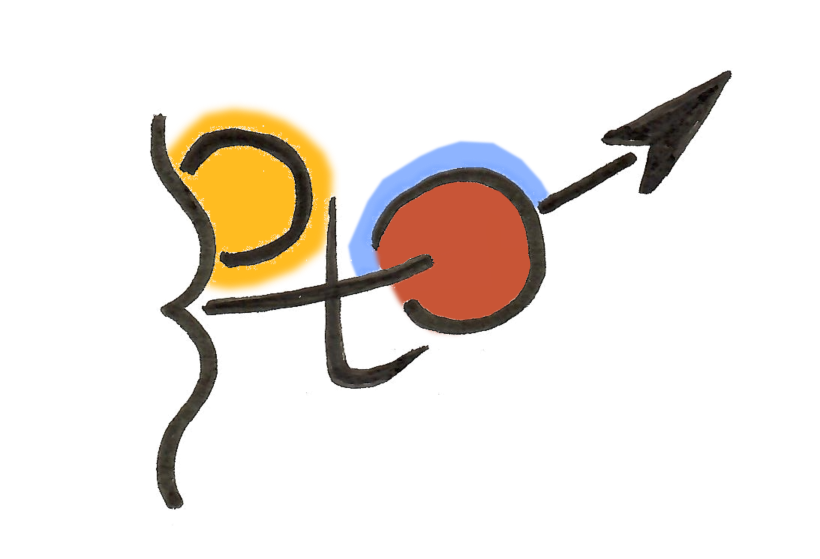LE BALADIN
DU MONDE OCCIDENTAL
de John Millington Synge
« Dans une bonne pièce de théâtre, chaque réplique devrait être aussi pleine de suc qu’une pomme ou qu’une noix ; or, de telles répliques ne peuvent être écrites par un homme vivant parmi des hommes qui ont fermé leurs lèvres à la poésie. »
J. M. Synge
Le Baladin du monde occidental
Sur les côtes sauvages du comté de Mayo, aux confins de l’Irlande, la vie est à l’unisson de la nature : les passions sifflent, grondent, tourbillonnent, et vous fracassent l’âme sur la falaise…
Cette nuit-là, le vent porte jusqu’à Pegeen un grand cri de rage et de liberté. Mais le freluquet qui se réfugie dans le cabaret clandestin de la jeune fille et qui prétend avoir tué son père d’un coup de bêche, avec ses mots sublimes et ses yeux hagards, est-il vraiment ce héros magnifique, nouvel Œdipe ou nouveau Christ, qu’elle attendait pour rompre ses fiançailles, ou n’est-il qu’un joueur, qu’un beau-parleur, qu’un playboy of the western world ?

Mêlant parler populaire et poésie, la pièce de Synge met au jour la part d’illusion nécessaire au réel, de mensonge nécessaire à la vérité. Elle ouvre une réflexion utile pour tenter de résoudre le paradoxe de notre société, spectaculaire et désenchantée, où démêler l’image de la réalité devient de plus en plus difficile, et défendre la place du poète dans la cité, de plus en plus urgent.
Françoise Morvan nous offre, en transposant l’anglo-irlandais en franco-breton, de découvrir le chef d’œuvre d’un auteur que les difficultés de traduction ont tenu longtemps éloigné du public français.